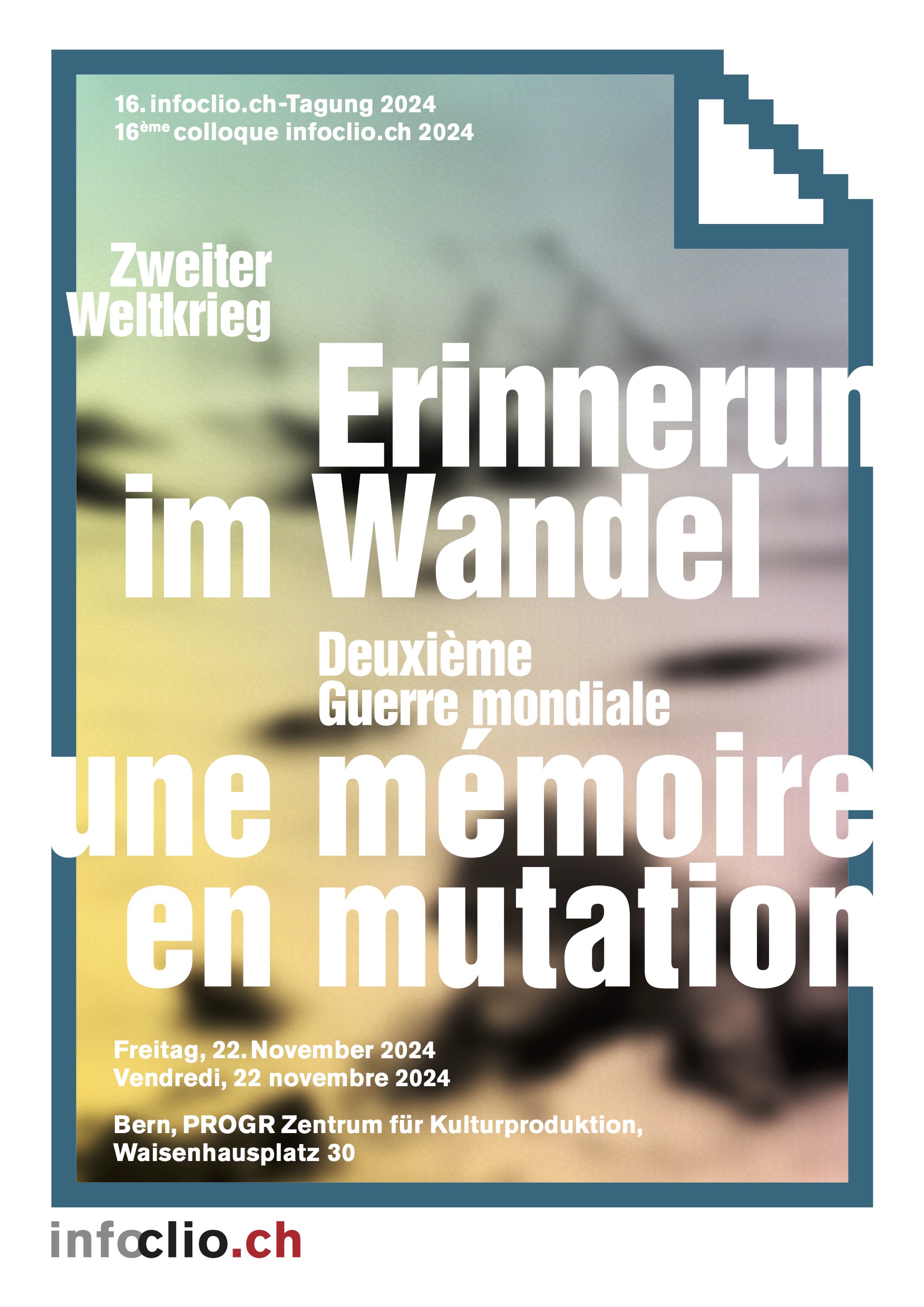Le texte ci-dessous évoque brièvement les raisons du choix de la thématique du colloque infoclio.ch 2024, consacré à la mémoire publique de la Deuxième Guerre mondiale et à ses développements contemporains.
La mémoire publique, un objet mouvant
Le terme de « mémoire publique » désigne les représentations du passé produites par des groupes ou des organisations dans l’espace social. Distincte de l’histoire, dont l’objet de recherche réside dans le passé, la mémoire est toujours intimement liée au temps présent. Elle s’efforce de donner un sens au passé au sein de l’époque actuelle ; elle établit des ponts entre hier et aujourd’hui. Si elle tend à être consensuelle, au point de paraître parfois monolithique, elle est en réalité diversifiée, à l’image des groupes qui s’y investissent, et peut devenir un terrain de conflits. On parle alors de « mémoire divisée » ou de « guerre des mémoires ». La mémoire publique prend diverses formes : monuments, commémorations, expositions, films, etc. Et la mémoire publique évolue dans le temps, en fonction des sensibilités et des contextes politiques.
La mémoire publique de la Deuxième Guerre mondiale possède donc une histoire, qui commence déjà pendant la guerre et se poursuit jusqu’à aujourd’hui. L’époque actuelle, justement, est caractérisée par de profondes mutations qui méritent qu'on s'y arrête.
Une mémoire en mutation au 21e siècle
En effet, en ce début de 21e siècle, au moins trois éléments appellent une réflexion sur l’évolution actuelle cette mémoire publique.
La disparition de la génération des contemporains des évènements est un premier élément. Elle pose la question de la perpétuation de cette mémoire, alors qu’il n’y aura bientôt plus de témoin pour raconter ce qu’ils ont vécu, et de comment la transmettre aux nouvelles générations, alors que les moyens d’accès à l’information se sont radicalement transformés et que les évènements historiques en question semblent de plus en plus lointains.
Second élément : les sociétés contemporaines se sont largement diversifiées sur le plan culturel. La mobilité des personnes et les migrations ont composé des sociétés plus hétérogènes – les Allemand utilisent le terme « post-migrantische Gesellschaft » - au sein desquelles une partie croissante de la population a un autre type de rapport avec la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, lié parfois à d’autres mémoires, notamment en lien avec les entreprises coloniales des empires européens.
Enfin – et c’est l’élément le plus saillant à notre époque - la montée en puissance de partis populistes d’extrême droite dans de nombreux pays pose de nouveaux défis à ces mémoires publiques. Ces formations, souvent directement issues, ou idéologiquement proches, des anciens régimes autoritaires en place lors de la Deuxième Guerre, cherchent activement à infléchir et contester les mémoires publiques pour lever le stigma qu’elles font peser sur elles, et améliorer ainsi leur acceptabilité politique.
Ces facteurs ne font que confirmer que la mémoire publique est intimement liée au temps présent et évolue avec lui. Dès lors, l’objectif de la conférence infoclio.ch 2024 est de reparcourir l’histoire de la mémoire de la Deuxième Guerre en Suisse et chez ses voisins, et d’en discuter ses développements contemporains.
Une mémoire suisse longtemps mythifiée
En Suisse, la mémoire publique de la Deuxième Guerre mondiale s’est longtemps basée sur un «oubli organisé»1 ou un «refoulement du passé»2, soit le mythe d’une Suisse indépendante et neutre, terre d’asile, qui aurait maintenu sa souveraineté pendant la guerre exclusivement grâce à son armée et à la résilience de sa population. Pourtant, depuis les années 1950 déjà, la recherche historique a mis à jour une réalité différente, celle d’une Suisse qui a fermé ses portes aux réfugiés civils juifs et maintenu des relations économiques avec l’Allemagne nazie tout au long de la guerre, jouant ainsi un rôle non négligeable dans le financement de son économie de guerre. Cette histoire a mis longtemps à trouver une place dans la mémoire publique en Suisse.
Avec les excuses du Conseiller fédéral Kaspar Villiger en 1995 pour le rôle de la Suisse dans l’introduction du tampon «J» dans les passeports des Juifs allemand dès l’automne 1938, puis la publication, en 2001, des recherches de la Commission indépendante d’experts Suisse Deuxième Guerre mondiale (commission Bergier), une mémoire publique plus critique a trouvé un écho au sein de la population suisse, tout en continuant à susciter des oppositions.
L’histoire de la mémoire publique de la Seconde Guerre mondiale en Suisse est entre-temps bien documentée. Le lecteur se réfèrera à cet article du Dictionnaire historique de la Suisse, aux publications de Regina Ludi et de Christina Späti, à celles de Jakob Tanner (tous trois invités du colloque infoclio.ch 2024) ou encore à cet article de Charles Heimberg pour un aperçu du sujet.
Un nouveau mémorial suisse pour les victimes du national-socialisme
La Suisse n’a jamais érigé de monument commémoratif aux victimes civiles de la Deuxième Guerre mondiale. Cela est sur le point de changer : en 2022, le parlement suisse a adopté deux motions (Jositsch 15.03.2021 ; Heer 16.03.2021) qui demandent la création d’un Mémorial suisse pour les victimes du national-socialisme.
Le concept de ce mémorial se base sur trois piliers : un monument commémoratif à Berne dans la capitale fédérale, un musée dans le Canton de St. Gall, à la frontière avec l’Autriche, et un réseau national de compétence. Depuis, un premier financement a été attribué et les travaux ont commencé. Le mémorial devrait voir le jour avant la fin de la décennie. Ce nouveau mémorial, de même que d’autres initiatives suisses récentes, seront présentés lors du colloque.
Des mémoires au cœur des identités européennes
Dans les pays voisins de la Suisse, la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale s’est institutionnalisée depuis longtemps déjà, avec toutefois des différentes significatives entre les pays.
En Allemagne, un champ de recherche et une réflexion critique sur les crimes du national-socialisme se sont constitués peu à peu à partir des années 1960. Cette mémoire a ensuite été institutionnalisé à partir des années 1980 et pris une place importante dans la politique mémorielle de l’Allemagne réunifiée. Elle est aujourd’hui remise en question sur plusieurs fronts, en particulier par les forces politiques d’extrême-droite. Volkhard Knigge, historien et directeur émérite du mémorial de Buchenwald, viendra discuter de ces évolutions.
En France, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale s’est d’abord basée sur la célébration de la Résistance, laissant de côté jusqu’aux années 1970 le pan d’histoire lié au régime de Vichy et à sa collaboration avec l’occupant allemand. Au cours des décennies suivantes se consolide la figure mémorielle de la victime juive, alors que les politiques de mémoire s’institutionnalisent au plus haut niveau de l’État. L’historien spécialiste des politiques mémorielles Denis Peschanski viendra parler du cas de la France lors du colloque infoclio.ch 2024.
En Italie, la mémoire publique de la guerre s’inscrit dans une tradition antifasciste – issue de la résistance italienne - qui ne s’est toutefois jamais confrontée de manière approfondie avec l’histoire de l’Italie fasciste. La mémoire publique italienne est par ailleurs le théâtre d’affrontements politiques brûlants et a toujours fait l’objet de nombreuses contestations internes. Luciano Canfora, philologue de renommée internationale mais aussi commentateur attentif de l’histoire politique italienne, présentera le cas de l’Italie lors du colloque infoclio.ch
A l’échelle de l’Union européenne, la Deuxième Guerre mondiale constitue l’évènement fondateur qui mène à sa création. Pourtant, ce n’est qu’à partir des années 1990 qu’une politique de mémoire publique se constitue à l’échelle européenne. Basée sur le souvenir des victimes – juives en particulier - avec l’introduction en 2005 de la Journée européenne de commémoration de l’Holocauste, et le refus des régimes autoritaires, cette mémoire publique « antitotalitaire » est devenue un élément central de l’identité de l’Union Européenne, comme le rappelle notamment cette résolution adoptée par le Parlement européen en 2019.
La mémoire de la Deuxième guerre mondiale est donc actuellement au centre de l’actualité politique de plusieurs pays. Près de 80 ans après la fin de la guerre, le souvenir de la guerre continue de jouer un rôle important dans le devenir des sociétés européennes. La présentation de ces différents cas nationaux ainsi que la discussion des directions possibles pour l’avenir de cette mémoire de la Deuxième Guerre mondiale sera au centre du colloque infoclio.ch 2024. Le programme détaillé est en ligne ainsi que le formulaire d’inscription.
1 Ludi Regula, « Die Schweizer NS-Opfer und das organisierte Vergessen », in: Azaryahu Maoz, Gehring Ulrike, Meyer Fabienne et al. (eds.), Erzählweisen des Sagbaren und Unsagbaren. Formen des Holocaust-Gedenkens in schweizerischen und transnationalen Perspektive, Böhlau Verlag, 2021, p. 349-373.
2 Tanner Jakob, « «Die problematischen Seiten der Geschichte werden ausgeblendet» », Zürcher Studierendenzeitung, 09.2024, pp. 12‑13.