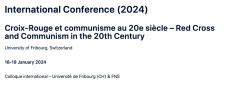Conférence internationale: Université de Fribourg, Suisse, 18-19 janvier 2024
L’humanitaire et le communisme ont entretenu tout au long du 20e siècle des relations complexes faites de confrontations, de défis et d’opportunités (souvent frustrées) et cela tant sur le plan idéologique que pratique. Partant de ce constat, ce colloque souhaite explorer l’ensemble des interactions, actions et influences réciproques entre le Mouvement Croix-Rouge — le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (SNCR), puis dès 1919 la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (LSCR, actuelle Fédération) – et les régimes et organisations communistes, ou plus généralement d’inspiration marxiste entre 1917 et 1991.
Phénomène à la fois national et transnational, les luttes révolutionnaires ont en effet favorisé l’émergence de conflits ainsi que d’acteurs et de victimes échappant au droit international humanitaire. Dès 1917, les humanitaires ont ainsi été confrontés à des problèmes de catégorisation des guerres civiles, empêchant la désignation des responsables de l’application des règles de la guerre, et de définition du statut des soldats capturés, qui en fonction du point de vue des belligérants sont considérés comme des détenus civils, des criminels ou des combattants. Mais au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, tant l’émergence des Démocraties populaires que les enjeux liés à la refonte du droit humanitaire amènent les Soviétiques à faire le choix de la participation au sein du Mouvement, ces derniers allant même jusqu’à revendiquer la paternité de la Croix-Rouge. En dépit de fortes tensions, l’URSS et ses alliés s’impliquent activement dans l’élaboration des conventions de Genève de 1949, puis des protocoles additionnels de 1977. Ils se saisissent aussi du Mouvement pour élaborer une diplomatie humanitaire commune aux Sociétés nationales des pays communistes unies dans la « noble lutte pour la paix ». Si les régimes communistes demeurent largement fermés aux interventions humanitaires sur leurs territoires, ils ne manquent pas d’utiliser leur Société nationale pour se projeter à l’étranger et jouer sur les rivalités du CICR et de la Ligue afin d’imposer leurs conditions. Pendant la décolonisation, certains des mouvements de libération nationale se réclamant du marxisme n’hésitent par ailleurs pas à utiliser le Mouvement pour obtenir des ressources ou des formes de reconnaissance sur la scène internationale.
Malgré l’ouverture des archives résultant de la disparition des régimes communistes sur le continent européen, et de celles du Mouvement Croix-Rouge, la relation entre le communisme et la Croix-Rouge est longtemps restée un impensé de l’historiographie. Ce colloque vise à inscrire cette question dans une histoire globale de l’humanitaire en plein renouvellement, en privilégiant une approche sociale et politique des acteurs et des actrices impliqué.e.s dans cette dynamique de confrontation et d’inclusion. Le comité d’organisation du colloque propose d’articuler le questionnement autour des trois axes de réflexion suivants.
– Un premier axe s’intéressera au niveau idéologique et politique. Comment des conceptions différentes de la solidarité, des conflits armés et de leurs victimes, ainsi que du droit international sont-elles entrées en tension ? Comment se sont-elles manifestées et comment les différents acteurs en jeu ont-ils cherché à les contourner ou parfois à les exacerber ? Tant l’anticommunisme de certaines des institutions de la Croix-Rouge, que les critiques et les modèles alternatifs proposés par les acteurs se réclamant du marxisme seront au cœur de la réflexion.
– Un deuxième axe portera sur la place des régimes communistes et des Croix-Rouges communistes au sein du Mouvement, tant sur le plan institutionnel que diplomatique. Il s’agira d’une part d’interroger l’histoire des Croix-Rouge des pays communistes. Quelles sont les spécificités de ces sociétés nationales ? Dans quelle mesure leur alignement avec le gouvernement fait-il débat au sein du Mouvement ? Quelles sont les dynamiques qui existent entre elles et comment collaborent-elles avec le reste du Mouvement ? D’autre part, on cherchera à saisir le rôle qu’elles jouent et que jouent les représentants des États communistes sur le plan diplomatique. Dans quelle mesure essayent-ils d’influencer les grandes orientations du Mouvement lors des conférences internationales et de peser sur l’élaboration du droit humanitaire ? Comment organisent-ils des formes de solidarités et promeuvent-ils une diplomatie humanitaire spécifique au sein du Mouvement ?
– Un troisième axe se placera au niveau du terrain et des pratiques des acteurs du Mouvement de la Croix-Rouge notamment dans les contextes de guerres révolutionnaires, d’insurrection ou de répression. Quels sont les problèmes spécifiques auxquels se heurtent ces acteurs quand ils souhaitent accéder aux détenus qualifiés de politiques et plus généralement aux territoires contrôlés par des autorités communistes, en contexte de conflit, voire de catastrophes naturelles. A l’inverse, comment les révolutionnaires mobilisent-ils le Mouvement de la Croix-Rouge ? Dans quelle mesure le recours à ce dernier représente-t-il une menace, ou au contraire une ressource ? Et comment ces perceptions évoluent-elles au cours du 20e siècle ?
Propositions
Merci de soumettre vos propositions en anglais ou en français (résumé d’environ 300 mots et courte biographie de max. 150 mots) d’ici au 25 juin 2023 à redcross-redstar@unifr.ch. Le colloque sera bilingue.
Le Comité d’organisation du colloque prendra en charge l’hébergement et le repas des participant.e.s pendant la durée de la manifestation. Merci d’indiquer également si vous avez besoin d’une prise en charge partielle ou totale de vos frais de transport.
Veranstaltungsort
Contatto
Ulteriori informazioni sugli eventi
Informazioni sui costi