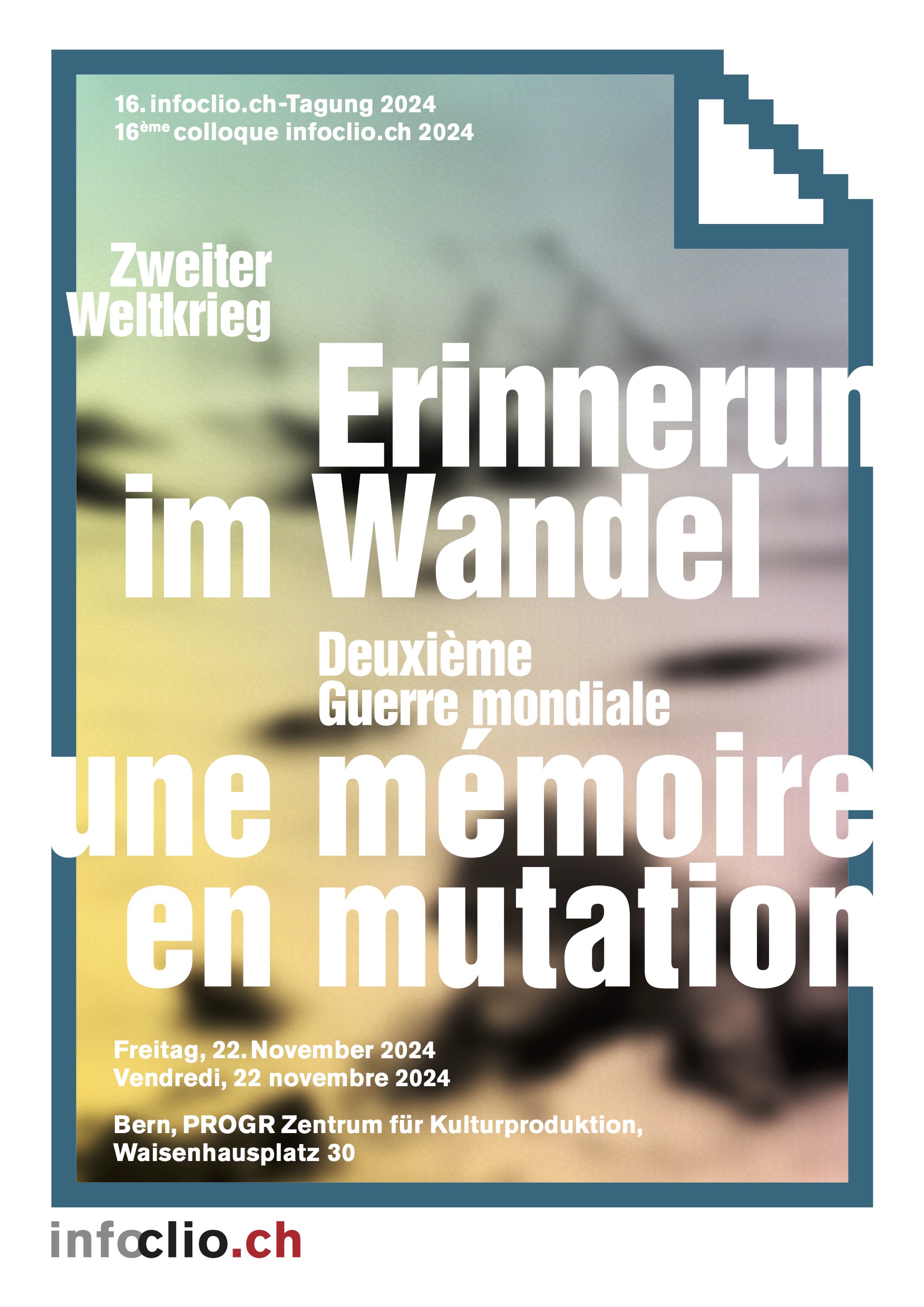Plus de 20 ans après la publication des travaux de la Commission indépendante d’expert·es Suisse-Seconde Guerre mondiale présidée par Jean-François Bergier, et alors que les derniers témoins de cette période sombre sont en train de disparaître, nous assistons à une reconfiguration mémorielle encore amplifiée par l’état du monde et l’air du temps. La question des droits humains sous-jacente à ce travail d’histoire et de mémoire est-elle réglée pour autant ? Rien n’est moins sûr.
Ce n’était pas la question principalement posée à la Commission Bergier, qui devait surtout traiter de questions économiques, mais l’enjeu d’histoire et de mémoire le plus significatif de ce dossier, sur lequel nous nous concentrons ici, concerne la question de l’asile, de l’accueil ou du refoulement de personnes juives en fuite cherchant à sauver leurs vies.
La figure de la sénatrice italienne Liliana Segre est révélatrice des enjeux actuels de ces reconfigurations mémorielles. Âgée aujourd’hui de 94 ans, placée sous protection policière dans son pays à la suite de menaces, elle avait été refoulée pendant la guerre à la frontière italo-suisse avec son père avant qu’ils soient l’une et l’autre déporté·es à Auschwitz, dont elle seule reviendra.1 Liliana Segre n’est pas importante aujourd’hui pour la seule raison d’avoir été victime de la politique suisse à l’égard des réfugié·es de la Seconde Guerre mondiale. Elle est en effet devenue une voix morale forte et une vigie face à l’extrême droite qui gouverne l’Italie, continuité d’un néofascisme qui affirmait ne vouloir ni restaurer, ni renoncer à son idéologie. Qu’en serait-il alors, si elle n’était plus là, pour la mémoire et la conscience démocratique de l’Italie ? Qu’en sera-t-il sans elle ?
Cette interrogation, pour l’Italie comme pour la Suisse, concerne l’un des aspects de la transformation en cours de la configuration mémorielle des drames de la Seconde Guerre mondiale, et plus largement des régimes fascistes et de leurs crimes. La disparition de leurs derniers témoins intervient dans un contexte de montée des extrêmes droites à l’échelle européenne. Les pires idéologies identitaires et discriminatoires ont le vent en poupe alors que les crises contemporaines – guerres, dérèglement du climat et de la nature – rendraient nécessaires de toutes autres options.
Plus de vingt ans après une crise et un travail d’histoire et de mémoire
Début 2002, quand la Commission Bergier a rendu ses travaux, le monde politique n’a pas voulu en débattre sur le fond et les documents privés mis à disposition ont dû être rendus. Les quelques mesures prises alors pour en tirer des conclusions utiles et lutter contre le racisme et les discriminations se sont limitées à soutenir des initiatives ponctuelles de sensibilisation, à l’exclusion de mesures plus durables, notamment pour les écoles. Or, aujourd’hui, alors que des ressources pédagogiques destinées à tous les élèves des cantons francophones, les Moyens d’enseignement romands2, ont été élaborées et diffusées, force est de constater la grande pauvreté des informations qu’elles donnent à ce propos, allant jusqu’à laisser entendre, sans les présenter vraiment, que les travaux de la Commission Bergier étaient discutables et discutés.3
En Suisse, la question des refoulements de victimes juives du nazisme était présente d’emblée dans les consciences à travers des controverses qui avaient déjà mené au rapport Ludwig de 19574 mais aussi des productions culturelles comme l’Andorra de Max Frisch au début des années soixante.5 Elle l’est restée constamment, mais à bas bruit, au cours des décennies suivantes. Cependant, après la fin de la guerre froide, la Suisse, au sens restreint de ses autorités et de ses élites économiques, s’est retrouvée sur la sellette et a dû entreprendre un important travail d’introspection. Elle avait pourtant eu cette idée étrange, en 1989, de « célébrer » les cinquante ans la “Mob”, la mobilisation générale des hommes suisses à la frontière, alors que se discutait la raison d’être de son armée à l’occasion d’une initiative populaire. Au cours des années ultérieures, les remises en question de cette mémoire restée largement complaisante furent d’autant plus marquantes, provoquant de l’incompréhension parfois virulente parmi les contemporain·es de cette Mob, et même quelques pointes d’antisémitisme.
La crise des fonds en déshérence et ses suites, en particulier la publication du rapport Bergier6 ont pu laisser penser que plus rien ne serait jamais comme avant et que les mythes complaisants du récit traditionnel de la Suisse et de ses élites face au national-socialisme n’étaient plus d’actualité. Plus de vingt ans après, cela reste en partie vrai, mais la prise de conscience rendue possible par ce travail d’histoire et de mémoire se révèle néanmoins fragile.
Une tendance à l’occultation des faits les plus gênants
Les autorités suisses se sont par exemple engagées pour la mémoire de la destruction des juifs d’Europe, en participant notamment à l’Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah (IHRA selon l’acronyme en anglais). Cependant, en 2017, quand elles ont présidé cet organisme international, elles ont pris bien soin de n’évoquer que des victimes juives qui n’avaient rien à voir avec celles qui avaient été refoulées par la Suisse, à l’exception d’une implication dans un colloque du Mémorial de la Shoah à Paris consacré au cas helvétique.7 Par ailleurs, des initiatives pour le travail de mémoire ont été prises ponctuellement dans certains cantons, notamment autour de la Journée de la mémoire et de la prévention des crimes contre l’humanité du 27-Janvier. Un travail critique a également émergé dans le domaine du passé esclavagiste et colonial dont il a bien fallu admettre qu’il avait laissé des traces en Suisse aussi. Toutefois, en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, les reconfigurations mémorielles en cours demeurent assez préoccupantes. Elles sont produites par l’écoulement du temps qui nous éloigne aussi bien de l’époque de cette histoire que de celle, ultérieure, de la crise des fonds en déshérence et du rapport Bergier.
La contestation constante des travaux de la Commission Bergier dans l’espace public et médiatique a trouvé une relance récente avec une thèse doctorale prétendant redimensionner, en revendiquant une exactitude qui n’est pas compatible avec le caractère lacunaire des archives disponibles, le nombre de refoulements par la Suisse de personnes juives en danger, à ses frontières avec la France, voire dans leur ensemble.8
Par ailleurs, et en dehors de toute rationalité scientifique, les milieux de la droite extrême, particulièrement influents dans le monde en crise qui est le nôtre, se sont toujours opposés aux résultats des travaux de la Commission Bergier et exercent régulièrement des pressions contre ce travail d’histoire et de mémoire. En même temps, les travaux critiques sur cette période peinent à se renouveler autour d’une thématique qui n’est plus vraiment au premier plan des préoccupations. À côté de toutes ces marques de fragilité, l’inauguration récente à Genève d’un chemin Rosette-Wolczak, du nom d’une jeune fille juive mineure morte à Auschwitz après avoir été brutalement refoulée par la Suisse pour une prétendue « conduite indécente » (sic) qui concernait aussi des militaires9, constitue toutefois un signe de reconnaissance et d’espoir susceptible de nuancer ce tableau préoccupant.
Notes:
1 Heimberg Charles, « Journée de la Mémoire : le refoulement de Liliana Segre à la frontière italo-suisse », Blog Mediapart, Chroniques pour mémoires, 2022, <https://blogs.mediapart.fr/heimbergch/blog/270122/journee-de-la-memoire-le-refoulement-de-liliana-segre-la-frontiere-italo-suisse>, consulté le 07.10.2024.
2 Histoire 11e (Livre de l’élève & Fiches de l’élève), Conférence intercantonale de l’Instruction publique de la Suisse romande (CIIP), 2021 (Sciences humaines et sociales. Cycle 3).
3 À ce propos, voir notamment Heimberg Charles, « Initier à la saveur de l’histoire. Enjeux de vérité, défis de valeurs », Carnet de recherche, À l’école de Clio. Histoire et didactique de l’histoire, 2024, <https://ecoleclio.hypotheses.org/2058>, consulté le 07.10.2024.
4 Ludwig Carl, « La politique pratiquée par la Suisse à l'égard des réfugiés au cours des années 1933 à 1955 », Berne, Conseil fédéral, 1957. En ligne: <https://www.bar.admin.ch/dam/bar/fr/dokumente/verwaltungsgeschichte/E4001C_1000-783_2731.pdf.download.pdf/E4001C_1000-783_2731.pdf>, consulté le 07.10.2024.
5 Nous reprenons ici, et pour ce qui suit, des éléments de notre article Heimberg Charles, « Le pouvoir suisse face au nazisme à la Seconde Guerre mondiale: d’où viennent l’histoire et la mémoire critiques? », En Jeu (14), 2019. En ligne: <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:152973>, consulté le 07.10.2024.
6 Commission Indépendante d’Experts Suisse – Seconde Guerre Mondiale, La Suisse, le national-socialisme et la Seconde Guerre mondiale. Rapport final, Zürich, Editions Pendo, 2002. En ligne: <https://www.uek.ch/fr/schlussbericht/synthese/uekf.pdf>, consulté le 07.10.2024.
7 Dont les contenus ont été publiés ensuite dans Wisard François, Fivaz-Silbermann Ruth, Dubuisson Pauline (eds), La Suisse face au génocide. Nouvelles recherches et perspectives, Paris, Mémorial de la Shoah, 2019 (Revue d'Histoire de la Shoah 210). En ligne: <https://shs.cairn.info/revue-d-histoire-de-la-shoah-2019-1?lang=fr>, consulté le 07.10.2024.
8 Fivaz-Silbermann Ruth, La fuite en Suisse. Les juifs à la frontière franco-suisse durant les années de la “Solution finale”, Paris, Calmann-Lévy/Mémorial de la Shoah, 2020. Pour une mise au point critique de cette question, voir l’article de Perrenoud Marc, « Le rapport de la commission Bergier sur les réfugiés. Rappels et perspectives », Revue d’Histoire de la Shoah 210 (1), 15.10.2019, pp. 55‑83. En ligne: <https://doi.org/10.3917/rhsho.210.0055>, consulté le 07.10.2024.
9 Torracinta Claude, Rosette, pour l’exemple, Genève, Slatkine, 2016; Heimberg Charles, « Rosette, pour l’histoire et pour mémoire », Blog Mediapart, Chroniques pour mémoires, 2016, <https://blogs.mediapart.fr/heimbergch/blog/130716/rosette-pour-l-histoire-et-pour-memoire>, consulté le 07.10.2024. Cette reconnaissance tardive de la mémoire de Rosette Wolczak n’aurait pas été possible sans les travaux de Claire Lucchetta-Rentchnik, notamment sa mallette pédagogique Faisons parler la frontière ! Guide pour itinéraires scolaires. 1939-1945, Genève, DIP, 2010. Claire Lucchetta-Rentchnik a aussi été l’initiatrice de la pose d’une plaque commémorative devant l’École des Cropettes à Genève rappelant son rôle comme « camp de triage de l’armée pour les réfugiés ». Voir Ville de Genève, «Communiqué de presse 27 janvier 2016», Geneve.ch, 2016, <https://www.geneve.ch/document/plaque-commemorative-cropettes-communique-presse-janvier-2016>, consulté le 07.10.2024.