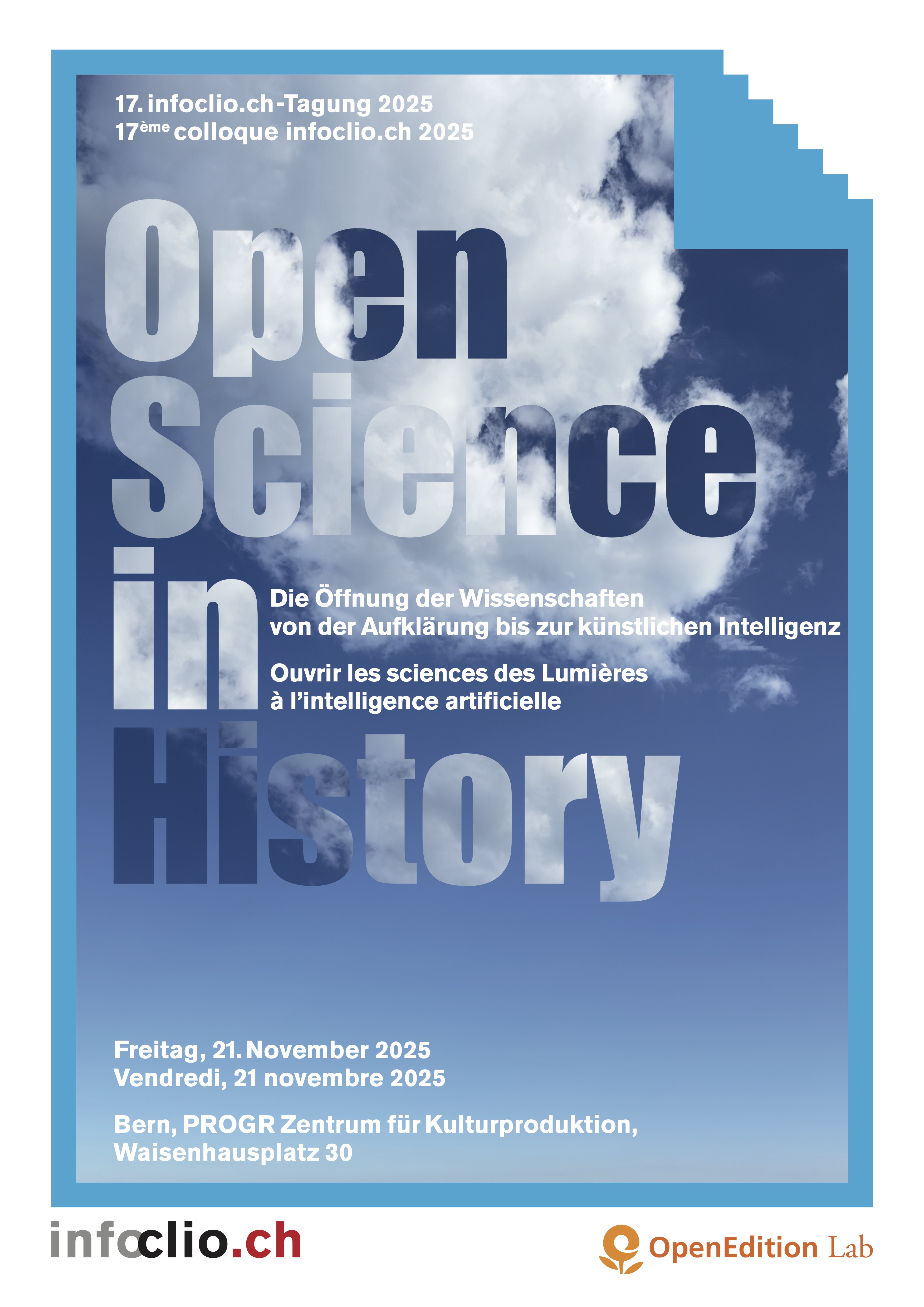Ce billet revient sur la table ronde «Grands enjeux du rapprochement entre Citizen Science et Open Science» qui a eu lieu à Lausanne en juin 2025 lors de la conférence CitSci' Helvetia 2025. Le billet, rédigé sur la base d'une transcription automatique d'un enregistrement audio, est édité par Simon Dumas Primbault (Open Edition Lab). Il fait partie d’une série de billets consacrée à l’actualité de l’Open Data dans les sciences humaines et sociales en Suisse, produite à l’occasion du colloque infoclio.ch 2025 «Open Science in History». La série présente divers projets récents, signale des ressources accessibles en ligne et propose des réflexions sur le sujet.
Introduction
La table ronde organisée le 6 juin dernier avait pour ambition d’explorer une articulation encore fragile mais prometteuse : celle de la science ouverte et de la science citoyenne. Deux dynamiques qui, bien qu’elles partagent un même horizon d’ouverture, d’accessibilité et de participation, peinent encore à se rejoindre dans les faits — du moins dans les politiques de recherche et les structures institutionnelles.
Réunissant chercheur·ses, responsables de stratégies open science, praticien·nes des sciences participatives et membres d’institutions suisses et françaises, cette rencontre a permis de mettre en lumière les convergences possibles, les tensions latentes, et les leviers à activer pour construire une science plus juste, plus démocratique, et plus pertinente socialement.
Intervenant·es :
Gérard Bagnoud (Directeur du service des Ressources informationnelles et archives (UNIRIS) de l'Université de Lausanne)
Micaela Crespo-Quesada (Directrice adjointe du Service de la recherche et responsable Open Access à l'Université de Lausanne)
Mélodie Faury (Professeur junior de “Recherches sur les sciences participatives”, Museum national d’histoire naturelle, Paris)
Alessia Smaniotto (Ingénieur et chercheuse sur les sciences citoyennes et participatives à OPERAS, OpenEdition)
Tizian Zumthurm (Coordinateur du Swiss Expert Group for Citizen Science, Schweizforscht - Tous Scientifiques)
Modérateurs :
Simon Dumas Primbault (OpenEdition Lab, CNRS)
Enrico Natale (infoclio.ch)
Une diversité de définitions comme richesse
Dès les premières prises de parole, un constat s’impose : les termes de "science ouverte" et "science citoyenne" sont porteurs de visions multiples et parfois contradictoires. Et loin de rechercher une définition unique, les intervenant·es insistent sur la nécessité d’assumer cette pluralité.
« des collègues du groupe international de citizen science ont listé les 32 définitions qui existent de citizen science, donc laquelle est la bonne ? Je pense que pour moi, ce n'est pas une question », rappelle Alessia Smaniotto. « Ce que j'aime bien en citant cet article-là, c'est de rendre hommage à la diversité des pratiques de recherche participative. »
Mélodie Faury, quant à elle, revendique une posture critique et transdisciplinaire :
« J’ai toujours considéré un continuum de questionnements plutôt que des cadres normatifs ou des identités professionnelles. [...] Dès lors qu’on croise des types de savoirs, [qu’on] crée du dialogue entre différents registres, on est dans des démarches science-société, et donc participatives. »
Pour Tizian Zumthurm, historien des sciences, la coexistence de définitions divergentes tient à l’origine même du terme citizen science, introduit simultanément dans les années 1990 par deux chercheurs... aux visions opposées :
« [L’un entendait] par là une démocratisation de la science ; [pour l’autre,] la mobilisation de volontaires pour la collecte de données. »
Et de souligner que cette ambivalence originelle explique la grande diversité des pratiques que l’on regroupe aujourd’hui sous ce terme.
Un défi pour la science ouverte : aller jusqu’au bout de l’ouverture
Si la science ouverte a connu une forte institutionnalisation — notamment via les stratégies nationales d’open access et de gestion des données — les recherches participatives restent souvent en périphérie des dispositifs, voire absentes.
« la Citizen Science est un peu le parent pauvre, en tout cas au niveau de l'institutionnalisation de cette problématique au niveau fédéral », note Gérard Bagnoud, en soulignant qu’aucune stratégie fédérale suisse ne lui est actuellement consacrée.
Pour plusieurs intervenant·es, la science citoyenne représente pourtant le prolongement logique, voire le test ultime des promesses de la science ouverte. Elle invite à élargir le champ des bénéficiaires, des contributeurs et des formes de savoir reconnues.
« Si on regarde la définition de l'UNESCO, on a cette dimension d'ouverture-partage, la dimension de collaboration [...] les sciences citoyennes en tant que moyen d'ouvrir le processus de recherche, sont presque l'expression ultime de la science ouverte. », affirme Micaela Crespo-Quesada.
« Ouvrir, collaborer, mais ouvrir aussi le processus, c'est vraiment à travers la science citoyenne. »
Mais cette ouverture intégrale bouscule les cadres habituels : elle remet en cause les protocoles, les circuits de validation, les critères d’excellence. Elle implique aussi une reconfiguration de la gouvernance des projets de recherche.
Comme le dit Mélodie Faury :
« je voulais entrer par la question de qu'est-ce que ça transforme dans nos pratiques de recherche, en fait. Et pour moi, c'est là où les deux vont ensemble, sciences ouvertes et sciences citoyennes, participatives, quel que soit le nom, ne sont pas uniquement des sensibilisations de la société, des implications de l'autre, ou le cycle de la recherche qu'on trouve dans la recommandation UNESCO, qui est un référentiel de recherche. C'est aussi une transformation de la recherche elle-même, et que l'institution accepte ou refuse. »
Ainsi, il ne s’agit plus seulement de rendre accessible un produit fini, mais de rendre visibles les processus, ce qui suppose d’autres outils, d’autres rapports de pouvoir, d’autres critères de pertinence.
Des institutions en tension : entre ouverture affichée et inertie structurelle
Sur le terrain institutionnel, les approches divergent. Si certains établissements (comme l’Université de Lausanne) ont intégré dans leur stratégie l’open access, les données ouvertes, et parfois la participation, c’est souvent à l’initiative de professionnel·les convaincu·es, plus qu’en réponse à une volonté politique claire.
« Je me suis auto-saisi [de cette mission de science ouverte] », raconte Gérard Bagnoud, soulignant que l’impulsion vient parfois de l’intérieur, et s’appuie sur des fenêtres d’opportunité, comme les changements de rectorat.
En France, des dynamiques nationales comme le label "Science avec et pour la société" (SwafS) ont permis de structurer des initiatives, mais elles peinent à s’inscrire durablement dans les politiques de recherche, notamment dans Horizon Europe, où les volets participatifs ont été largement affaiblis.
« On a eu un moment fort avec Horizon 2020, les principes de l’ECSA, les appels SwafS… Mais dans Horizon Europe, tout ça a été balayé. Citizen science est redevenu synonyme de collecte de données », déplore un intervenant du public.
Les infrastructures : entre conditions de possibilité et obstacles épistémologiques
Au croisement de la science ouverte et des recherches participatives, les infrastructures apparaissent à la fois comme leviers et verrous. Si elles offrent des outils, des espaces, des protocoles pour organiser, partager et rendre visibles les travaux scientifiques, elles incarnent aussi des choix techniques et politiques qui influencent — parfois à l’insu des chercheurs — ce qui est considéré comme recherchable, partageable ou publiable.
Alessia Smaniotto, impliquée dans OpenEdition et OPERAS, en montre la portée concrète :
« Comment fait-on pour mettre un article de recherche participative dans une base de données ? Ce qui n'a rien d'une évidence, car l'infrastructure de ces bases-là n'est pas pensée pour des auteurs multiples et des diversités de contributions. C’est là l'une des questions que nous devons résoudre en tant que praticiens de recherche participative et membres d'infrastructure. »
Cette observation rejoint la critique de Pauline Gourlet, qui pointe la manière dont les infrastructures imposent en creux une certaine normalisation de la recherche :
« Je ne me reconnais pas du tout dans les données parce que j'ai des données empiriques de verbatim, des heures d'entretien, etc. Donc, en fait, on ne parle aussi pas du tout de la même matière, et [...] en tant que chercheurs, chercheuses, c'est beaucoup plus difficile de faire exister nos recherches dans ces infrastructures-là. Donc, je me demande si cette stratégie d'open science, data access, on l'appelle comme on veut, n'a pas tendance, malgré elle – c'est-à-dire que ce n'est pas forcément l'intention qui est derrière – à favoriser un certain type de recherche. »
Selon elle, les infrastructures favorisent de manière implicite certains types de recherche, certaines épistémologies, au détriment d’autres formes — plus qualitatives, plus incertaines, plus ancrées dans les pratiques de terrain. Ce biais peut conduire à invisibiliser des travaux, voire à les rendre inéligibles aux appels à projets.
Simon Dumas Primbault propose de prolonger la réflexion pour une table ronde future :
« Quel rôle joue l'infrastructure comme condition de possibilité de la science ouverte, des sciences citoyennes, de leur articulation, ou pas ? Est-ce que l'infrastructure est porteuse essentiellement d'une épistémologie qui empêche cette diversité épistémique ? [Car] l'un des principes même de l'infrastructure, c'est de désambiguiser, selon un terme assez courant dans des épistémologies d'ordre computationnel. Et l’on en revient au début de cette table ronde à Mélodie, qui se refusait à devoir définir, ou questionnait la nécessité de définir les termes, et donc peut-être d'habiter une forme d'ambiguïté ou une forme d'incertitude sur la signification même de ces termes-là et leur pouvoir dans le champ scientifique. Donc il y a quelque part un paradoxe, une aporie ou une injonction contradictoire entre la nécessité d'habiter l'incertitude et puis une nécessité de désambiguiser les pratiques via les infrastructures. »
Autrement dit, la standardisation requise pour faire fonctionner les infrastructures — formats, métadonnées, référentiels, taxonomies — peut écraser les spécificités des démarches participatives, qui reposent sur le dialogue, l’évolution en contexte, la co-construction lente et située des savoirs.
Cette critique ne vise pas à rejeter les infrastructures, mais à appeler à leur transformation. Pour que les infrastructures servent la diversité des pratiques scientifiques, elles doivent être flexibles, co-construites, réflexives, capables d’accueillir des objets et des processus non normés.
Plaidoyer, stratégie, coalition : les leviers pour transformer
Face à ce constat, plusieurs pistes ont été évoquées. L’une d’elles consiste à mobiliser des textes de référence internationaux comme la recommandation de l’UNESCO, qui permet d’inscrire la participation dans la définition même de la science ouverte. Autre levier : changer les critères d’évaluation de la recherche, via des coalitions comme COARA.
Mais surtout, il s’agit de reconnaître les savoirs et les engagements déjà existants, souvent invisibilisés ou considérés comme périphériques. Et de penser la recherche comme un droit, non comme une prérogative réservée à quelques-uns.
« Faire plus de sciences ouvertes ou plus de recherches participatives, pour changer les mentalités aussi, ce serait de dire que faire de la recherche est un droit. Ce n'est pas un devoir. Et c'est un droit pour tout le monde, en fait. Et le fait de rendre accessibles les publications, de rendre accessibles les données, de rendre accessibles les espaces de recherche, c'est une façon de remettre sur la table le fait que tout le monde a le droit de faire de la recherche, et que donc, pour cette raison-là, une raison absolument civique, nous devons faire de l'accès ouvert, des données ouvertes, de la science ouverte, de l'échange participatif », insiste Alessia Smaniotto.
Tizian Zumthurm ajoute qu’il faut aussi reconnaître que ces pratiques prennent du temps, qu’elles ne s’inscrivent pas dans les logiques de productivité classiques. Et que pour cela, il faut changer les modes de financement et d’évaluation.
Conclusion : tenir la ligne, malgré les vents contraires
La table ronde s’est conclue sur une note lucide : la période actuelle, marquée par des logiques de fermeture (sécurité, compétition, financiarisation), n’est pas favorable aux approches ouvertes et participatives. Et pourtant, il n’est pas question de renoncer.
« On sait aussi qu'on est en train de traverser une période qui va être particulièrement compliquée. Et pour autant, on ne peut pas ne pas faire ce qui nous importe. Je ne parle pas toujours la langue de l'institution. Je veux bien parler ce double langage, c'est-à-dire comprendre comment le financeur pense, les indicateurs pensent, etc. Mais quand je vois ce que ça... démembre ou ampute, parfois, je refuse de le faire. [...] Je pense qu'on est toujours en train de changer de position. Travailler au cadre d'une université, proposer des plaidoyers, dire dans quels termes on voudrait que ça se pose et en même temps continuer de faire. Parfois avec moins de moyens, parfois dans des situations, du coup, de précarité institutionnelle, de contre-coups politiques aussi au niveau de nos situations individuelles et collectives. Je trouve ça assez intéressant et important de voir tous les niveaux d'action sur lesquels on se trouve et qui, finalement, il n'y a pas une bonne façon de faire, on va dire. », affirme Mélodie Faury.
Il faut faire avec, faire à côté, faire contre — mais faire quand même. Dans cette perspective, les réseaux militants et professionnels (comme Alliss, Réunis, les boutiques des sciences) jouent un rôle crucial. Ils permettent de penser autrement, d’expérimenter, de soutenir les porteur·ses de projets dans des contextes parfois précaires, et de construire une vision partagée d’une science en dialogue avec la société.